-
Trop tard

Ton regard me manque, tu sais. La tendresse insistante de ton œil timide, cette affection silencieuse et ces gestes pudiques, graves et fragiles, aussi purs que ce que nous fûmes le temps d’un embrasement qui ne connut ni les heures ni les âges, en faisant toujours semblant de ne pas le nommer, de ne pas l’inscrire dans le temps, encore moins dans les mœurs, de ne rien figer. C’est le destin des cœurs fugitifs et le fardeau des âmes nomades. Nous aurions pu nous aimer comme tout le monde mais nous avons préféré nier l’abattement des certitudes. Nous avons vécu. Nous nous sommes croisés. Nous avons brûlé.
Mais s’aimer ? Jamais. S’accommoder du regard des autres, tolérer l’insupportable suspicion, en rire puis en pleurer, non…
Au début, nous nous cachions. La nuit, nous nous poussions l’un ou l’autre dans l’alcôve d’une porte cochère, sous un arbre, derrière une église pour nous embrasser avec toute la fougue et la générosité d’un premier amour. Nos yeux humides se révélaient à la lueur d’un lampadaire. Et lorsque quelqu’un passait, je couvrais ta tête dans ma nuque pour que personne ne te reconnaisse. Nous nous aimions en embuscade, quelque part entre le mur des cons et celui des fous, coupables de passions innommables parce que trop jeune et surtout parce que trop vieux. Parce que trop marié, aussi. Bagué l’année de ma naissance. C’est ce qui s’appelle : être née trop tard. Beaucoup trop tard.
Les semaines et les mois passant, l’usage eut été de rompre cet attrait au sabre froid, de disparaître au grand jour puisque nous nous aimions aux grands soirs. Mais nous avons continué. Et de dîners en rendez-vous intimes, nous avons brisé l’idéal impossible pour bâtir l’idéal interdit. Nous voilà amants, amoureux, si vulnérables et si forts, guettant toujours le regard des autres pour ne pas être pris en flagrant délit de tendresse. Je découvre aussi la troublante obsession du vide. L’après-toi. Le temps qui fauche et celui qu’il reste. Je la regarde cette flamme qui brille, qui brûle et qui consume. Je la regarde qui danse et qui nous attire, brûle nos ailes et nos vies, pauvres imbéciles en sursis…
Et après… Que fait-on des cendres d’un si grand amour ? Que restera-t-il après nous ? Un visage qui s’efface, des parfums qui s’évaporent, des silences insoutenables et des nuits à chercher ton regard, la tendresse insistante de ton œil timide, cette affection silencieuse et ces gestes pudiques, graves et fragiles, aussi purs que ce que nous fûmes le temps d’un embrasement qui ne connut ni les heures ni les âges…
-
La fleur des temps

Lorsque j’aurai atteint la fleur de l’âge, je me pencherai sur le berceau du monde, sur celui qui nous vit naître, aimer et mourir. Nous nous regarderons sans sourire, sans pleurer, comme deux vieux enfants épuisés par ce siècle, abandonnés à la fureur du temps, jetés en pâture dans un océan de désamour et de faux triomphes. Je deviendrai esclave d’une civilisation qui s’achève au firmament de son existence, qui s’effondre lourdement et sans bruit, qui s’étouffe avant d’avoir vieilli, qui tombe en bâillant. Je n’aurai plus la force, plus l’envie. Et nos larmes seront si peu de choses devant un tel embrasement… Mais là-bas, dans les flammes, la cendre noir, l’air irrespirable, dans cette nuit sans lune, dans ce brouillard inommable, une croix magistrale s’élèvera. La croix de Notre-Dame, la croix de la Résistance, la croix de Verdun, la croix des hommes qui prient en silence, la fleur hivernale, l’apothéose avant l’apocalypse, frappée des armes de la France, drapée d’un linceul tricolore, trophée des morts et fardeau des vivants, médaille des pauvres et misère des géants. Nous la regarderons, lassés et fiers. Fatigués. Amoureux.
-
Le dernier panache
Le soleil frappe les champs à peine moissonnés et les pâturages en friches. Les machines tournent, les brebis tirent la langue, deux jeunes agriculteurs se sont endormis à l’ombre de leur tracteur, dans l’herbe sèche… Une version contemporaine de Monet. Je m’échappe à travers la plaine, sur ces chemins que je connais par cœur. Fatalement, donc, cette évasion est un échec. Mais si mes pas tiennent la route avec une redoutable constance, mon regard, lui, a déjà dépassé l’horizon. « À quoi bon marcher, il n’y a rien de beau derrière… » L’instinct fait face à la dissidence. Je voudrais m’arrêter là mais mes jambes m’entraînent vers ce destin qui m’insupporte. Mon âme s’est évanouie sur le bord de la route. Et je doute qu’un bon Samaritain ne lui vienne en aide. « Passez votre chemin, il n’y a plus rien à en tirer. Sa seule richesse, c’était la France… »
Nous sommes le 5 août 2023. Hier, nous avons quitté les pâturages bourguignons pour le bocage vendéen. Le sol est humide, le soleil boude mais au Puy du Fou, les genêts sont en fleurs.
En renouvelant ma visite au Puy du Fou, je crains de ne pas être touchée par cette mélodie jouée au fil du temps, par ce feu ardent qui embrase nos cœurs et fait frémir nos âmes d’enfants, par ces parades de héros qui nous indiquent le chemin des plus nobles espérances… J’imagine même quitter ces lieux comme on quitte vulgairement un office en faisant valser la petite porte grinçante du fond de l’église sous des regards inquisiteurs, lassée d’entendre monter les mêmes prières vers un ciel HLM dans lequel se battent tant de dieux. Ce que j’espère pourtant, c’est redevenir la petite apatride des années précédentes. Celle qui se retourne après avoir franchi la frontière en réalisant qu’elle pourrait tromper son drapeau pour d’autres armoiries. Celle qui regarde tristement l’horizon décliner en pensant que demain, le jour se lèvera de nouveau, oui, mais sur un monde devenu si laid qu’elle préférerait retenir la nuit.
Tandis que ma famille se dirige vers le Bal des Oiseaux fantômes, Philippe de Villiers m’appelle : « Venez au Manoir de Charette, il faut que je vous montre quelque chose. » Je m’exécute. Il est 15h30, le soleil apparaît enfin.
Une voiture s’arrête sur le parking du Manoir. Je m’installe à l’avant : « Vous m’enlevez ? » Philippe sourit et m’annonce : « Je vous emmène là où personne ne peut encore aller. » La route se change rapidement en chemin rocailleux puis en allée de terre. Et soudain, une annexe du paradis.
Philippe amorce une manœuvre dans les fourrés d’un terrain vague : « Vous voyez, là, c’est vraiment le bocage vendéen ! » Au volant de sa Citroën, le créateur du Puy du Fou arpente le nid de son futur spectacle, une nouvelle page d’Histoire inscrite dans la légende puyfolaise. « Ce ne sera pas avant 2027, précise-t-il, mais le projet est fou ! » Niché dans un écrin d’arbres centenaires, un étang se révèle et donne à ce lieu tout « le romantisme » voulu par Philippe. « On accompagnera les formes du terrain » dit-il en suivant de la main les courbes du vallon.
Depuis sa création, en 1989, le parc ne cesse d’accroître sa superficie et poursuit son œuvre à travers des spectacles originaux. À l’aube de la saison 2023, les équipes du Puy du Fou annonçaient justement l’inauguration d’un nouveau projet à 20 millions d’euros, Le Mime et l’Étoile. L’histoire se déroule aux prémices du cinéma muet dans un décor en noir et blanc où évoluent 120 acteurs devant une estrade de 2000 spectateurs. Et soudain, les studios boisés se changent en promenade parisienne entre les colonnes Morris et les vieilles enseignes. Le décor ne se fige jamais, des véhicules se fraient même un chemin entre les danseurs et les badauds… L’innovation technique épouse le récit et le résultat est impressionnant.
Retour au terrain vague. « Dans quelques années, lorsque vous reviendrez ici, vous vous souviendrez d’où nous sommes partis », sourit-il en portant son regard vers l’étang, les chaussures trempées, traînant ses vieilles semelles entre les ronces et les herbes folles. En attendant, Philippe de Villiers poursuit ses repérages et puise en ces terres l’inspiration de ses prochains spectacles, ces témoignages d’amour, de lumière et d’esprit.

-
Carnet politique N°1
26 septembre 2022. 7h40. Un crachin plonge la rue du Cherche-Midi dans une ambiance plutôt morose. En quelques jours, le ciel printanier s’est affaissé. Les nuages ont repris possession des toits haussmanniens et les mines se sont assombries. « Comme un lundi », pensé-je. Mais un lundi d’anniversaire. Thomas et moi nous arrêtons au Grillon le temps d’un café servi au comptoir, entre les riverains et les ouvriers. Nous nous dirigeons ensuite vers le point de rendez-vous fixé par Guillaume, à une encablure de là. L’attente ne sera pas longue. Pourtant, ce sont souvent ces rares et courts instants de répit qui vous incitent à tout remettre en doute. De l’utilité de votre propre engagement à celui de l’homme que vous avez choisi de suivre jour et nuit. De cette situation singulière à cette vie que vous avez décidé de consacrer à la patrie, entièrement, à travers le moindre service, le moindre mot, la moindre action, la moindre minute passée à attendre dans cette voiture, en double-file. Mais à attendre quoi ? A attendre qui ? Et à quoi bon ? A cet instant, tout m’échappe. Et je n’ai pas l’intention de courir après des certitudes qui se font la malle. Autant affronter le doute. Même quelques secondes.
Peut-on servir son pays noblement à travers la politique ? Peut-on réellement aider les Français à partir de discours, de programmes et de stratégies de communication ? Peut-on reconquérir les cœurs, réconcilier les âmes et ressusciter cet idéal dans l’esprit de ceux qui l’ont déjà abandonné, ou qui ne l’ont jamais connu ? Peut-on vraiment changer le court de l’Histoire en invoquant sans cesse « l’art du temps long », quand tout, jour après jour, nous plonge un peu plus dans l’abîme ? Une phrase de mon père spirituel me revient alors : « A quoi sert de gagner le monde si c’est pour se perdre soi-même ? » Mais une seconde bouscule cet instant de sagesse : « Il y a un temps pour tout. » Et ce temps ne nous appartient plus.
Je m’étais emportée à ce propos, cet été, en appelant Guillaume pour lui confier mes incompréhensions, mon insatisfaction, ce sentiment d’abandon, d’impuissance partagé avec de nombreux militants… Et il m’avait tenu ce discours sur le temps long. En raccrochant, je m’étais dit : « Il n’a vraiment rien compris. » Puis je me suis imposée un moment de silence, justement. De déconnexion. Il me fallut apprendre qu’entre ma vie de journaliste, de l’immédiateté, de l’urgence, et celle de collaboratrice d’un homme politique, il y avait un précipice temporel. Que, comme tout le monde, je m’étais sans doute un peu laissé dévorer par les réseaux sociaux, par cette communication permanente qui empêche les esprits d’éclairer le monde, un monde ébloui par les écrans, l’inconsistance de l’information de masse et le bruit strident de la rumeur. Mais tout de même. Le temps long n’est rien sans le temps court. Et tout va si vite.
Une silhouette apparaît dans le rétroviseur. C’est lui. Il termine sa cigarette, traverse la rue, ouvre la portière et passe la tête dans la voiture : « Joyeux anniversaire Maud ! »
-
Sur les chemins noirs
Au fil du temps, et après avoir tant couru, je m’aperçois que la vraie chance, ce n’est pas de pouvoir se retirer du monde, de fuir la société, de disparaitre des réseaux sociaux, de refuser les cookies, de se mettre en mode avion et d’habiter une île imaginaire. C’est d’être capable de chasser le monde qui se loge en soi. C’est de retrouver ce petit jardin intime dans lequel on faisait naître des héros, des histoires, des légendes, des promesses, des rêves de gosse qui deviendraient un jour réalité. C’est, dans un moment de peine ou de révolte intérieure, d’avoir la force, quand même, de reprendre les chemins inachevés. Ça ne veut pas dire repartir en arrière, ça veut dire recommencer. C’est pour ça qu’on lit, qu’on écrit, qu’on se souvient, qu’on se laisse bouleverser par des choses futiles, des rencontres, des regards, des moments qui ne coûtent pas un sous mais qui valent tout l’or du monde. C’est pour ça qu’il faut s’émerveiller sans cesse, être naïf de temps en temps, pleurer pour rien et rire de tout, s’enivrer, se tromper, s’enlacer, se quitter, se manquer, se retrouver. Et laisser toute la place au hasard. Parce que tout le bonheur du monde se trouve dans l’imprévu. Il faut être capable, de temps en temps, de clore son agenda, de manquer un rendez-vous, de quitter sa routine, de lever les yeux et de regarder autour de soi. De ne commander rien d’autre qu’un billet de train ou qu’un verre de vin.
Alors pour répondre à cette envie de rien dans un monde obscurci par le tout, je me suis acheté un ticket de cinéma. Et de cet enfermement naquit une échappée, une évasion statique sur les Chemins noirs de Sylvain Tesson.
Voir ce film sans avoir lu le livre fut fut un peu comme partir en randonnée avec des chaussures neuves. Ma première réaction lorsque l’écran s’éteignit fut même d’imaginer que ces paysages eurent été plus joliment écrits que filmés. Qu’on aurait peut-être davantage souffert de lire ces larmes que de les regarder couler. Mais de toute façon, je n’y allais pas en pensant que ce serait le film de l’année. J’y allais en pensant qu’il me conforterait dans ma folie d’exil. Je voulais entendre ce cri venu d’un autre monde, de derrière les cimes, qui te dit : barre-toi. La France t’attend. Pas les Français, pas les urnes, pas l’Histoire : la France. Sylvain Tesson a rendu quelque chose possible. Il a ouvert des chemins. Il y a versé sa sueur, son sang, ses larmes et son encre parce que la France le réclamait. Elle était assoiffée de témoignages d’amour. Elle avait besoin qu’on l’éprouve, qu’on l’étreigne, qu’on se casse la gueule pour nous aider à nous relever. En descendant les marches de la salle de cinéma, je me suis sentie plus morte que vivante. Il y avait quelque chose d’irrationel, d’irrespirable. J’ai cherché l’air, le ciel, les arbres. J’ai alors quitté ce monde débile, ce que je cherche à faire tout le temps en disant à mes potes et à ma famille que « je pars », « mais tu pars où ? », « je ne sais pas, loin », « mais tu reviens quand ? », « tout à l’heure, demain, dans un mois, jamais »… Et soudain, la nuit est tombée. Pas dehors, il fait encore jour à 20h. Mais en soi, il se faisait déjà tard. C’est cet instant tragique où vous vous apercevez que la vie va beaucoup trop vite. Alors vous montez sur votre scooter, vous démarrez en trombes, vous dévalez la rue Claude Bernard – la tête dans les nuages, vous passez devant Le Café d’Avant, vous voudriez vous arrêter mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes en retard. Et parce que ça va trop vite. Vous vous rappelez de cette nuit où vous étiez complètement bourrée, à pleine vitesse dans la ville, les feux n’avaient aucune couleur, ou plutôt si : ils étaient tous rouges. Mais là, à ce moment précis, vous êtes sobre et vous roulez vite quand même. Personne ne vous attend, pourtant, mais vous réalisez que vous avez passé votre courte vie à vous manquer vous-même et qu’il s’agirait de vous donner rendez-vous, un jour. Voilà. Ce n’est pas un grand film. Mais c’est une grande histoire qui conduit à une formidable ivresse. Il ne s’agit pas de renier le monde moderne, il s’agit de s’en évader quelque temps pour retrouver aux confins du pays tout ce que les écrans ne nous offriront jamais : les parfums, la matière, les blessures et la vie. Ce film n’est pas à voir. Ce livre n’est pas à lire. Ils sont à vivre.
-
Parlement du peuple
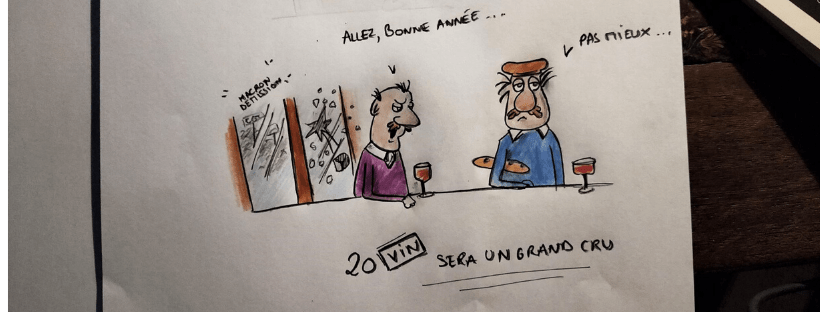
La porte de l’agence immobilière se referme derrière moi. « C’est ça, la France », pensé-je. Le souffle d’un commerçant exaspéré derrière un plexiglas. La déclaration d’amour d’un agent immobilier à sa région. Quand on n’a plus que son espoir à vendre et que son avis à donner, on ne réclame plus de gros chèque, seulement l’or du temps.
C’est le verre de rosé quotidien au PMU, à 9h du matin. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième, surtout ; ce sont les portières gelées de la Peugeot, les -4°C de la semaine dernière, les brèves de comptoir qui valent un programme politique, le passé qu’on regrette, l’avenir qui rend fou, les 400 coups, les 135 balles, la fermeture de l’usine, les bancs de l’école séchée et ceux de l’église à vendre, cette terre qu’on ne quitterait pour rien au monde, et les copains, forcément, ceux du bar, ceux d’avant, ceux qui restent et ceux qui s’en vont.
Ce sont ces odeurs d’arrière-cuisine, de galettes des rois, de croissants chauds, de cierges brûlés, de café moulu, de terre, de pluie, d’ici. C’est cette satire de la société, ces choses graves qu’on accueille avec légèreté, cet avis sur tout, cet avis pour rien. Ces visages marqués. Ces regards marquants. Et l’idée que quatre doses de piquette immunisent de tout. Y compris des emmerdeurs.
« Le comptoir est le parlement du peuple », écrit Victor Hugo. Et les piliers nous représentent plutôt bien. J’ai toujours pensé que les gilets jaunes n’auraient jamais pris les ronds-points si les bistrots de province n’avaient pas fermé. On se dit tout devant un ballon. Parfois trop. Mais un éclat de voix vaut mieux qu’un éclat de grenade.
Au Café Montparnasse, entre les fauteuils en cuir, les chaises en rotin, les rideaux en velours, les guéridons en fonte, les publicités d’antan, les lustres Belle-Époque épargnés par le grand remplacement suédois, ce comptoir en zinc et ce décor boisé, le temps ne s’est pas arrêté. Mieux, il a fait demi-tour. Dans cet urbanisme moderne, bétonné, bruyant, cette immense tonnelle rouge s’impose au nouveau monde comme un vieux phare. Comme un rempart. Une citadelle. Un bras de fer, de chair et d’or entre l’inénarrable beauté du temps passé et celui qui vient.
Ici, on aimerait tous les appeler Patrick ou Michel. Surtout lui. Celui qui vient d’entrer, les mains cachées dans les poches d’un pantalon trop large, les cheveux blancs, la mèche rebelle, le corps si fin et le regard si triste. Ce Michel là semble crouler sous le poids de sa veste. Il s’approche du comptoir, s’y accroche en interrogeant le garçon du regard et marmonne : « Un allongé sivouplé. »
Puis il attrape le journal et s’y plonge comme on se dérobe derrière l’écran d’un smartphone quand on ne sait pas quoi faire ni à qui parler. Entre deux lignes, il balaye les tables du regard, se heurte au mien, semble confus et retourne à sa fausse lecture. Trop tard, je l’ai remarqué. Lui, l’insignifiant. Lui qui incarne malgré lui cette petite France essoufflée, si belle mais si malade. Sacré Michel.
Sur l’autre rive, un vieux monsieur fait traîner ses semelles sur le trottoir morne de la rue Jouffroy d’Abbans, une demi-baguette dans les mains, les mains dans le dos, le dos voûté, les cheveux soigneusement peignés et le sourire naissant avant même d’avoir franchi le seuil du Rouergue. Il entre sans masque. Je ne me souviens pas de ses premières paroles, seulement de sa poignée de main avec le patron. Il sait où s’asseoir. Il ne commande pas. Son café est déjà prêt. « Les dernières nouvelles », clame le serveur en lui tendant Le Parisien. Le vieux monsieur le saisit avec enthousiasme et commence à le feuilleter. L’odeur du papier a trouvé ma table.
Un peu plus tard, une femme entre, en colère. J’entends « fait chier », « foutu virus ». Elle avale un petit noir aussi vite que son ombre et détale. Un autre monsieur s’installe au bar. « Tout va bien ? » – « Fort bien ? » – « Une orange sans glace ? » – « Et un café ! » On se passe les journaux. Le Parisien a changé de mains, Le Journal du Dimanche prend l’avantage et dans le feu de l’action, découvrant la Une consacrée aux candidats de la droite, le petit monsieur s’exclame : « Oh ! Dis ! Regarde-moi ça, ils ont mangé du bifteck ou quoi ? » Puis il se met à rire.
Au bout d’un quart d’heure, j’entends la chaise trainer des pieds, elle aussi. Le petite monsieur s’en va. Il replie le journal, le pose sur le comptoir, range poliment sa chaise et salue la compagnie sans s’attarder. Il revient demain. De l’autre côté du bar, on rigole comme des pochtrons. C’est le cri du coeur.
Dehors, la pluie commence à tomber. « On se croirait en octobre » disait le petit monsieur, tout à l’heure. Mais on s’en fout. Ici, les vieux abat-jours, les brèves de comptoir, les bruits de cuillère et l’odeur du café valent tous les soleils du monde. Le Bistrot est le deuxième parlement du peuple, c’est vrai. Un parlement où les voix comptent.
J’ai perdu la notion du temps, depuis le Covid. Mais je me souviens d’un texte écrit au crépuscule de cette longue et sinistre période. Il commençait ainsi :
Je veux revoir votre visage, Madame, sous la tonnelle d’un tabac. Vous qui rendiez le regard des hommes tellement imprudent, tellement fragile, parfois tragique, lorsque sous ce vieux guéridon, vous faisiez danser vos jambes.
Je veux revoir votre sourire, Monsieur. Relire le titre de ce fameux roman que vous n’avez jamais achevé – peut-être même ne l’avez-vous jamais commencé – et délivrer tous ces aveux emprisonnés dans les miroirs de ce Café.
Je veux revoir votre doigt glisser sur la carte du Flore, Mademoiselle, et votre œil pécher au chapitre des desserts. Je veux lire dans vos gestes, appliqués et maladroits, la moindre passion, le moindre étonnement, la moindre fracture qui justifierait votre extravagance ou absoudrait vos mauvais goûts. Je veux que vous m’inspiriez le moindre doute, le moindre mot, le moindre sentiment, et cette irrésistible envie de vivre et de revivre là où le temps n’a pas d’effets.
Je veux, Monsieur, vous voir m’offrir ce verre à une heure encore plus indécente dans un langage qui n’appartient presque qu’à vous, et vous quitter comme nous nous sommes rencontrés, anonymes.
Je veux siéger au parlement du peuple balzacien, à 7h, entre les tartines de beurre et la palette de porc, là où tout se joue, là où tout se pense, là où Audiard sévit encore.
Je veux commander une tisane à 19h au Carrousel, être moquée – à raison – par le patron, parier une vodka le lendemain matin et me ruiner en petits noirs toute la journée.
Je veux sentir l’odeur du café froid et du papier journal, chercher la monnaie manquante au fond de mes poches et réaliser qu’un inconnu a tout réglé.
Je veux revoir mon pays.
Je veux réécrire sur des coins de tables en bois ou sur les courbes d’un guéridon sous lequel vous faisiez danser vos jambes… Et pousser la porte du Select, vous heurter par accident, m’accrocher à votre regard quelques instants puis le laisser s’envoler, peut-être pour toujours…
Je voudrais vous recroiser, Monsieur, vous reconnaître, Madame. Je voudrais vous écrire, vous romancer. Et croire que vous vous souvenez aussi de tous ces moments anodins cueillis à la marge du temps dans ces troquets vieillots et ces brasseries de luxe rendues à l’occupant depuis le mois d’octobre.
-
Vestiges phocéens

« Revenez à Marseille au printemps, me dit-il, je vous montrerai les chemins qui bordent la cité. » Sortir des sentiers battus, larguer les amarres, laisser les quartiers perdus, s’éloigner de la ville au petit matin et la redécouvrir à la nuit tombée. Dans le regard azur de cet homme sans doute un peu rêveur, la phocéenne se pare à nouveau d’ors, d’espoir et de vertus. Loin des quartiers où prospèrent la délinquance et la criminalité, loin de ces bistrots où le patois devient même étranger.
Appuyé sur son étale de spécialités alsaciennes, sur le petit marché de Noël du Vieux Port, J.-R. me raconte ses voyages, son enfance, ses navigations et ses rencontres. L’aventure. A mille lieues de ce chalet factice. D’habitude, on l’aperçoit au fond d’une boutique de fabrications artisanales, derrière une façade bleue : « A chaque fois qu’un client entre, je le considère comme un ambassadeur de Marseille, alors je me fiche qu’il reparte avec un produit, tout ce que je veux, c’est qu’il reparte avec un sourire. » Et de toute évidence, difficile de ne pas y succomber.
Un peu commerçant, un peu philosophe, le Perpignanais reconnaît toutefois mener un train de vie « marginal » par rapport à la frénésie citadine. En somme, de 9h à 20h, J.-R. n’entrevoit Marseille qu’à travers sa vitrine. Le week-end, il longe ses côtes à travers mer, à bord de son voilier. Dans son quartier, les gens l’appellent « le milliardaire ». C’est le prix de la réussite : « Je crois que les Français sont de plus en plus fainéants et qu’ils supportent mal que l’on puisse profiter des fruits de son travail, de ses économies et de ses passions. »
Alors le soixantenaire se rassure, esquive les inquiétudes en riant de lui-même, s’échappe à nouveau vers ses souvenirs. De son enfance vécue dans une ferme, en sabots, à l’évocation de cette Italie qu’il dessine comme on caresse les courbes d’une femme… Du cancre qu’il était en classe à cette curiosité insatiable. De ces heures passées à feuilleter des livres, des dictionnaires, des encyclopédies pour épouser la langue française, à ce sentiment de ne pas s’être suffisamment battu pour la défendre. La délicatesse des mots, la richesse du vocabulaire, l’élégance de la formule n’ont, selon lui, pas survécu au laxisme de l’éducation moderne : « Maintenant, j’entends des femmes s’exclamer : ça me casse les couilles ! » Rude.
Dans quelques semaines, J.-R. reprendra le large. Seul. « Ma femme est déjà vieille, elle ne veut plus m’accompagner », plaisante-t-il à moitié… S’il ignore encore quelle sera sa destination, au-delà des 38 pays déjà parcourus, une chose est certaine : Marseille restera toujours son port d’attache. Quoi qu’en pensent les « journalistes parisiens », quoi qu’en pensent ses voisins, par amour peut-être, par vaillance sûrement, par fidélité, c’est sûr. La cloche annonce la fermeture du marché. Il me tend la main. La parenthèse se referme.
-
Roland Dumas, le vice vertueux

Nous sommes le 11 avril 2023. Il pleut. Je décide de sortir après avoir passé la journée au lit. Nous ne sommes plus à une incohérence près. J’emprunte l’avenue des Gobelins, le boulevard du Port Royal, la rue Vavin puis traverse le jardin du Luxembourg. Il est 19h44, les allées sont presque vides. Quelques coureurs cherchent laborieusement la sortie en pataugeant dans le gravier boueux. Les grilles ferment dans un quart d’heure.
Je pousse jusqu’au boulevard Saint Michel et m’égare dans les vieilles artères commerçantes où se mêlent déjà les odeurs de cuisine, de crêpes, de pizzas, de raclette et autres mets orientaux. Un couple s’embrasse dans une rue très étroite dont j’ai oublié le nom. On n’y distingue que deux silhouettes enlacées à l’abri du monde. « Paris est trop petit pour ceux qui s’aiment d’un si grand amour », écrivait Jacques Prévert. C’est l’anniversaire de sa mort. Sur l’autre rive, Notre-Dame dort encore et les passants la regardent tendrement. Le souvenir de cette épaisse fumée noire escaladant les tours me revient comme un vieux cauchemar. Le prix Maison Blanche, le champagne, l’euphorie, les mondanités… et soudain, l’effroi. Cette vision apocalyptique. Ce vacarme. Celui d’un cœur qui dégringole en soi. Plus rien n’a d’importance devant l’effondrement de notre civilisation. Je nous revois la contempler, impuissants, miséreux, éplorés, cherchant au fond de l’âme de quoi formuler un espoir, une prière… Même un cri. Certains répètent « c’est horrible, mon Dieu, c’est horrible ». Je crois que la suite ne fut que silence et bruits de pas se dirigeant vers la sortie.
Pont Saint Louis. Je franchis une Seine noire. Sur l’île, il fait déjà nuit. C’est l’heure où les vieux amants se prennent par la main en flânant jusqu’à la place Louis Aragon, avant de s’attabler aux Anysetiers du Roy, par exemple ; l’heure sublime où les jeunes amoureux se retrouvent en secret à l’angle de la rue Poulletier, les cheveux trempés et les regards en feu. C’est l’heure où l’on s’aime sans penser au lendemain.
En levant les yeux, j’aperçois de vastes bibliothèques, des plafonds peints, des poutres, des salons feutrés, ces lieux reculés du monde dans lesquels on aimerait parfois s’enfermer pour échapper aux led, au mobilier suédois et aux murs blancs. Je voudrais pousser ces portes cochères et sonner à ces appartements. Y sentir les parfums d’une cuisine en ébullition, y entendre un air de jazz et lire, pourquoi pas, les premières pages d’un roman au coin d’un feu. C’est curieux, quand même. Presque effrayant. Il y a quatre ans, je franchissais pourtant régulièrement le seuil de l’un de ces immeubles, quai de Bourbon. Je me souviens de cette porte grinçante et du bruit de clef dans la serrure. De cette salle à manger aux murs délavés, jonchée de sculptures, de poteries, de photos et de quelques dessins éparpillés sur la table en verre. Je me souviens de ce chapeau noir accroché au porte-manteau. De ce bureau de légende. Et de cet homme assis auprès duquel je passais des heures à écouter, à apprendre, à rire, à jouer, à imaginer son monde et à m’y sentir bien : Roland Dumas. Nous nous étions rencontrés dans l’appartement d’un écrivain, sorte de lupanar intellectuel niché sous les toits haussmaniens. C’était le 14 juin 2018. Dix jours plus tard, je me trouvais là, dans ce bureau, entre Max Ernst et Picasso.
Nous sommes alors le 25 juin 2018. Roland porte des baskets blanches. Adieu Richelieu, adieu Berluti. Dumas a désormais succombé au confort des semelles bon marché. C’est le prix de l’âge. De moindre élégance, peut-être, mais Roland ne fléchit pas : « J’ai fait retoucher ce costume pour l’occasion. » En séduction, c’est une pointure.
Après avoir beaucoup marché, il feint de se lever et m’invite à m’asseoir. Je lui tends d’abord la main, puis une boîte de chocolats, il les saisit en souriant : « Voyons, on s’embrasse ! » Svetlana nous sert deux verres d’eau puis se redirige vers l’entrée. Elle vit avec lui depuis 10 ans. Un ami le lui avait présentée, un soir. Elle ne parlait pas français, alors il lui a enseigné la langue… La porte claque, le silence tombe, nous voilà seuls.
Rien n’est inscrit dans le guide de cet entretien hasardeux. Nous parlerons sans doute d’histoire, d’art, de femmes et de morale. De ses passions déraisonnables et de son carcan spirituel. Homme de peu de foi mais dévot de la République, Roland est un pilier de l’acropole mitterrandienne. Tout, à priori, nous oppose. Incorrigiblement libertin, démesurément patriote, 96 ans, 75 de moins, de ce que fut la gauche, de ce que fut la droite, qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’ivresse… Roland loue de toute façon « le goût de voir les gens en face ». Tant mieux. L’appartement est calme. Il est 18h. Dans la pièce voisine s’élève un air de jazz.
« Que voulez-vous faire dans le journalisme ? » La récurrence de cette question me laisse paradoxalement toujours sans voix. Roland joint attentivement les mains et se met à sourire : « Vous êtes sensible, n’est-ce pas ? Émotive ? » Il se redresse en prenant difficilement appui sur ses accoudoirs et poursuit : « Vous devez saisir toutes les opportunités qui se présenteront à vous. Vous ne commencerez sans doute pas dans un grand journal, vous passerez par la rubrique des chiens écrasés, mais je n’ai pas non plus commencé par défendre Picasso. Il m’a fallu plaider pour de moindres causes. Je vous conseille les rubriques juridiques, les enquêtes, l’investigation. Ça vous fera rencontrer le monde que vous ne connaissez pas encore. Je vais vous donner plein de conseils pour devenir une grande journaliste. Vous êtes plutôt intelligente, belle et sympathique, vous vous intéressez au droit, à l’art, à la musique… Je vous prends sous mon aile. » L’illusion est ravissante. Il est vrai que nous avions respectivement évoqué nos goûts pour l’art, au cours de ce dîner. Roland était chanteur lyrique à ses heures secrètes. Il a même vécu quelques années auprès de la cantatrice Maria Murano, la grande passion de sa vie. S’il n’avait pas entamé une carrière politique, il aurait aimé faire de l’Opéra. Finalement, il a fait ses vocalises dans l’hémicycle… et quelle voix !
Nous ne tardons justement pas à évoquer la dernière campagne électorale. Roland me confie d’abord avoir plaidé en faveur de François Fillon : « Ensuite, je ne pouvais plus vraiment le soutenir avec toutes ces histoires. » Terrain miné. Comment ne pas revenir sur la perversité de cet homicide politico-médiatique. Soupçons calomnieux, perversion et profits poncifs dont il fallait trouver le bouc-émissaire. Pardonnez-moi cette insurrection de mauvaise foi, Roland, mais je n’ai rien digéré. Vous connaissez ça, le radotage journalistique, mais vous avez échappé au matraquage virtuel. Le 5ème pouvoir. Chaque semaine, la plupart des médias dégobillaient leur compte de rumeurs obscènes sur les réseaux sociaux, poubelle de la démocratie moderne, parlement de la foule, fosse commune de la pensée. Le débat n’était plus qu’une fiction.
Sur le terrain, les camps adverses finissaient même par se solidariser. Il fallait entendre ces témoins de Jupiter, pions blancs débarqués sur les marchés bondés, attaquant par des « il faut que » et des « non, vous ne pouvez pas comprendre ». Parce que quand on n’était pas d’accord, c’est qu’on était profondément idiot. C’est que « la réalité des choses » nous échappait. Je compatissais. La France assommée, acculée aux « extrémismes », tombait alors sous le charme mystique du nouvel élu, de l’Emmanuel, prophète de cette douce Europe aux douze étoiles… Dumas n’avait d’ailleurs jamais adhéré aux traités qui avaient précédé celui de Maastricht. Par la force des choses, l’Histoire l’avait conditionné dans ce rejet de l’Europe avant d’être rattrapé par les influents conseils de Mitterrand : « Je sais ce qui est arrivé dans votre famille, mais réfléchissez bien, regardez l’avenir ; l’Europe est la grande aventure de notre génération. » Ainsi fut-il. Lorsque le traité de Maastricht fit trembler les bancs et les consciences de l’Assemblée, Dumas employa le verbe à vau-l’eau, converti au mitterrandisme pour toujours.
La musique s’est arrêtée : « Prenez un chocolat. » Dumas refuse de m’entendre dire que je dois soigner ma ligne. Et pour appuyer sa contestation, son regard a déjà levé les voiles de la décence. C’est le jeu. Audacieux, malsain peut-être… Après tout, « qu’est-ce que la vieillesse, demandait Mitterrand, c’est d’abord de perdre la curiosité. » Avant d’épouser la politique, Roland ne pratiquait pas encore la séduction à outrance. Mais « le pouvoir érotise », dit-il. Ce pouvoir ne l’a jamais quitté.
Il me raconte qu’il a acquis cet appartement en 1956, alors qu’il entrait à l’Assemblée Nationale. Il n’avait que 34 ans – le plus jeune député avec Jean-Marie Le Pen qui en avait 27 – et n’avait pas encore un rond. Alors, un jour, il aperçut une annonce dans Le Figaro : appartement à vendre, 19 quai de Bourbon. La propriétaire vivait entre ses chats et ses enfants dans cet appartement devenu insalubre. Il demandit à l’Assemblée l’aide qui lui était due en tant que jeune élu et acheta le 19. « J’ai eu une sacrée chance ! » Sacrée dose de caviar… L’appartement est situé au rez-de-chaussée d’un hôtel particulier, face à la Seine. Les fenêtres de son bureau donnent sur la cour.
Ici, donc, vécut la sculptrice Camille Claudel, calfeutrée avant d’être internée. C’est d’ailleurs Roland qui ordonna la mise en place d’une plaque informative sur la façade de l’hôtel particulier. Il est toujours amusant de voir quelques badauds s’y arrêter, ne sachant désormais quel autre personnage occupe ces murs. A l’époque, Roland ignorait encore quels illustres artistes il serait amené à défendre. Le hasard est farceur et plutôt généreux.
- Vous recevez toujours ?
- J’ai surtout beaucoup reçu, mais de temps en temps, une belle femme vient sonner à ma porte…
Roland me parle aussi de son père, Georges Dumas, fusillé par les nazis le 26 mars 1944. A 95 ans, l’évocation de ce traumatisme révèle encore d’intraitables blessures. Il se reproche de ne pas être resté avec lui lorsque les Allemands sont arrivés. Mais il fallait résister. Il avait alors enfourché son vélo pour rejoindre les compagnons des Mouvements unis de la Résistance. « Vous ne vous sentez tout de même pas coupable », lui demandé-je. Il se sent surtout triste. Toute sa vie, il l’a construite sur ces fondations filiales. « Pour moi, il n’y a qu’un critère, qu’un repère, c’est la vie. J’ai tellement mesuré que je perdais tout avec la mort de mon père que le reste n’est qu’écumes des vagues », écrit-il dans son autobiographie, Coups et Blessures.
Dans son bureau, un dossier porte le nom de « Georges Dumas 1914-1918 ». « J’aurais aimé le connaître davantage », se confie t-il. Un soir, il l’avait aperçu agenouillé au pied de son lit, en prière. Il n’était, à sa connaissance, pourtant pas croyant. Mais il n’a pas osé l’interrompre. Il le regrette. Roland ne croit pas non plus en Dieu, mais il aborde le sujet régulièrement : « Ce qu’il y a de sérieux, dans la religion, c’est la morale. Je ne crois pas que les véritables athées existent. Ils doutent forcément, tout le monde doute. Vous allez à la messe, vous ? » L’Eglise m’apparaît aujourd’hui moins fréquentable, mais j’y ai passé de longs moments, avec des histoires spirituelles extrêmement fortes. Roland songe beaucoup à la foi chrétienne. Il ne s’est jamais laissé tenter par le nihilisme, ni convaincre par l’athéisme. Rationnel, curieux mais étonnamment prudent, Roland n’en demeure pas moins spirituel. Évidemment, lorsqu’on évoque la prêtrise, il y répond avec toute la sincérité et la tendresse que l’on sait : « J’aime trop les femmes. » Ce pourrait être son acte de contrition.
- Au fait, Maud, au niveau de votre vie sentimentale, ça se passe comment ?
Mitterrand, enfin. Je l’interroge sur leur relation en formulant à demi-mot : « Puisque vous consacrez Léon Blum en sorte de père politique, Mitterrand n’avait-il pas pour vous une figure paternelle autrement plus intime, voire spirituel ? » C’est un peu bancal comme entrée en matière.
- Très bonne question… Je crois que oui. Et la mort de mon père l’intriguait beaucoup. A la fin de sa vie, alors que je venais à son chevet à peu près une fois par semaine, il me posait beaucoup de questions sur lui. Un jour, je lui ai demandé : François, que regrettes-tu le plus ? Et il m’a répondu : je regrette de ne pas t’avoir suivi sur la question de l’Algérie. C’était un vrai aveu.
François Mitterrand n’était pour moi que la parfaite incarnation de « l’homme de droite soumis à une politique de gauche. » C’est ce qu’on me disait. Un homme figé dans l’Histoire qui avait suscité tant de fantasmes, tant de soupçons, tant de secrets et d’indignations… Il était la France d’après de Gaulle, un personnage dont on ne parle pas tellement en cours d’histoire et au nom duquel peu sont légitimés à s’exprimer. Mais un visage bien incrusté dans ce paysage sans horizon.
L’ombre de Mitterrand plane toujours dans cet appartement qui s’assombrit un peu plus. Le soleil a quitté l’île Saint Louis.
Roland Dumas a été journaliste pendant 7 ans. Il faisait « des petits boulots d’avocat » et a rencontré une femme dont l’ami était le propriétaire d’un journal : « Je n’ai pas sauté que sur l’occasion ! » Sacré salaud. Il exerçait dans la rubrique économie et jouissait d’une attention particulière de ce directeur (d’où le salaire de 3500 francs qu’il avait eu l’audace de demander), lié par le sang de l’Histoire. Ses deux fils avaient été fusillés par les nazis. « Ça vous casse », souffle Roland. A cette époque, il n’avait pas grand-chose, la guerre lui avait tout confisqué.
Nous arrivons au terme de notre rencontre, au bout d’une heure et demie. « Ecrivez-moi, dit-il, je vous répondrai. Il faut qu’on se revoie. » En nous levant, je lui soumets l’un de ses ouvrages. Il y appose son écriture un peu tremblante, « …avec mes sentiments de grande affection. » Et poursuit en levant les yeux : « en attendant plus. »
« Quel jour sommes-nous ? » Le 25 juin 2018, Monsieur Dumas.
« Vous avez de très belles chaussures », me nargue t-il d’un air malicieux. Le temps n’atteint pas les goûts. Il se lève, me prend par le bras puis me raccompagne jusqu’à la porte de son bureau. « Je suis très heureux de vous avoir revue. Je veux qu’en me quittant, vous vous souveniez des mots de ce vieux Roland Dumas : vous êtes capable de beaucoup de choses. La vie vous appartient. Ayez confiance en vous. »
11 avril 2023. Il est 21h. Je remonte la rue du Cardinal Lemoine à pas lents. Paris n’est belle que les soirs de pluie.
-
Jean de France

Il y avait une cigarette écrasée dans un cendrier. Un guéridon en bois, des chaises en rotin et du marc de café abandonné au fond d’une tasse rouge, près de la porte. L’intemporalité.
Il y avait une femme esseulée que le serveur avait oubliée. Assise dans l’angle mort. Un bonjour sans réponse prononcé sous un masque qui lui ôtait ses derniers traits d’humanité. Les cheveux mal coiffés, un vieux manteau rouge, des baskets neuves, un collant noir et une jupe, sans doute, sur laquelle elle était assise. Une mine triste. Un corps las. Les yeux mi-clos posés sur ce téléphone muet. Et le serveur qui ne venait pas. L’attente.
Il y avait un vieux monsieur aveugle guidé par son chien. Le café habituel, sans sucre, consommé à la même place chaque matin, et servi avec un sourire qu’il devinait. Sans doute se laissait-il distraire par la conversation des trois hommes assis à sa droite, tantôt piano, tantôt forte, dont on ne captait finalement que de brèves conclusions : « T’es qu’un con. » L’esprit français.
Il y avait le dos courbé de ce pilier de comptoir appuyé sur le zinc, une casquette vissée sur la tête, les bras croisés, les épaules remontées jusqu’aux oreilles. Rabougri. Mais debout. De temps en temps, lorsque le serveur repassait derrière le bar, il lui faisait un signe de la tête. Ça valait mieux que des politesses insignifiantes. Puis il replongeait en lui-même. La solitude.
Il y avait ce personnage zolien. Le visage creusé, le regard cafardeur, les cheveux noirs peignés en arrière, un blazer en velours sombre porté sur un gilet marron et une chemise qu’on distinguait à peine, le col apparaissant sous un nœud de foulard rouge ; de longues mains posées sur la table, l’une trouvant de temps en temps l’anse d’une tasse désespérément petite, l’autre glissant lentement sur les lignes d’un journal ouvert : Libération.
Il y avait un petit bout de France en chacun d’eux. Une France poète, une France triste, une France de gauche, une France d’avant. Une chanson douce. Le parfum du café chaud et celui du tabac froid qu’on emporte avec et malgré soi, comme une seconde peau, comme un agréable fardeau, comme un étendard vivant dans ce monde de morts. Un petit peu d’amertume dans ces vies fades. Il n’y avait rien de beau. Rien de glorieux. Rien de grand. Rien de risqué. Rien d’impossible. Rien d’important. Rien de fou… Mais rien, rien… c’est souvent tout.Nous sommes le 19 avril 2023. « C’était une soirée d’anthologie », m’écrit Etienne. Une soirée interminable entamée dans un bar du 9ème arrondissement avec Floran Philippot au Perrier tranche, achevée dans un restaurant avec André Bercoff et Jean Lassalle au Pinot Noir. La première partie fut consacrée aux 30 ans de Jordan Florentin, entre Juliette Briens, Baudouin Wisselmann, Bahia Carla et l’indicible Philippot. Après quelques joyeuses mondanités, Etienne et moi avons finalement décidé de prendre congé, pensant chacun regagner notre oreiller. Mais les plans changèrent lorsque nous croisâmes la rue ***.
Je fis d’abord remarquer à Etienne qu’il s’agissait de la rue d’André Bercoff et qu’avec un peu de chance ou d’audace, nous aurions pu l’y croiser et lui proposer de prendre un verre au pied de son immeuble. Et dans une grande simplicité, l’improbable se produisit : « Mais qu’est-ce que tu fais en bas ? Je descends ! »
André n’a jamais manqué un rendez-vous, contrairement à moi. S’il est en retard, il appelle. S’il est indisposé, il reporte. Mais il n’annule jamais. Alors quand l’imprévu sonne à sa porte, il dévale les escaliers et le rejoint avec ce rire grave, inimitable, doublé de cette éternelle accroche : « Comment va ma gendarmette ? »
Nous passons un quart d’heure ensemble et balayons d’un revers de main les sujets d’actualité pour ne plus parler que de lui. L’émission de Bourdin, le salon d’Omerta, un weekend à la campagne et ce désir fou, toujours, de refaire le tour du monde. André possède une qualité inestimable rejettée par tant de confrères : la curiosité. « Je pose la question », répète-t-il inlassablement aux affabulateurs qui se complaisent dans le relai de vérités infondées, pourvu qu’elles buzzent. Beaucoup le considèrent comme un fou, mais « la grande leçon de la vie, c’est que parfois, ce sont les fous qui ont raison », écrivait l’un des leurs. Au fond, Bercoff est un peu le Churchill du journalisme français.
Mais l’heure est à la sagesse et André doit se lever tôt. Nous nous quittons donc en nous promettant de nous appeler demain. Soudain, mon téléphone sonne. C’est Jean Lassalle. Je le sais à Paris depuis hier et lui propose donc de nous rejoindre au bar, comme ça. Etienne interpelle de responsable du restaurant qu’il connaît bien : « Tu n’imagines pas qui va venir ! » Sacha, la serveuse, interrompt sa course et répond quelque chose comme : « Avec toi, je crains le pire. » Sa réputation droitière le précède. Nous finissons par lâcher le morceau. Deux amis nous rejoignent pour étoffer la table et la conversation. Et une heure plus tard, Jean apparaît à l’encoignure de la rue. La terrasse se lève. Les clients abondent. Il est 23h30.
Nous n’aurons jamais assez d’une vie pour raconter celle de Jean. Et encore moins d’un soirée. Jean Lassalle est un idéaliste insaisissable qui poétise la terre et provoque en nous le désir de la servir, de l’aimer, de la fouler, de l’étreindre, de l’épouser. Cette terre de feu, de vie, de mémoire, de culture, de France. Il aime son pays à en crever. Peut-être maladroitement, mais il l’aime dans ses recoins et dans ses largeurs, sur ses chemins de terre et ses bancs en velours. Il l’aime parce qu’il l’a parcourue comme un paysan. Il l’aime dans les yeux de chacune de ses rencontres, il l’éprouve, il en a même beaucoup souffert. Lassalle a des défauts, bien-sûr. Il parle encore de l’extrême droite comme de la terreur et est incapable de cohérence lorsqu’il s’agit de se positionner sur l’immigration. Alors à défaut de comprendre le politique, nous aimons le personnage. Je me souviendrai toujours de cette évasion, au salon de l’agriculture. De ces moments où Jean Lassalle ne se révèle qu’en rires, en poésie, en tendresse, en revanchard, en amoureux, en indécis, en homme abîmé par la vie mais si fort dans le devoir. Je l’ai découvert enfant malmené et homme plein d’espérance. Debout pendant 10h, tiré de tous les côtés, dansant, chantant, hurlant, buvant, fêtant la France et la paysannerie comme personne d’autre… Il fallait ensuite l’entendre disserter sur ce qu’il avait vu et entendu, épuisé, mélancolique, mais si fier d’eux, de ces Français qui lui ressemblent. Jeunes, vieux, cadres, paysans… Il fallait le voir donner son numéro à tous ceux qui le réclamaient et répondre aux innombrables messages. Jean Lassalle aurait dû s’appeler Jean de France.
Vers 2h30, après nous avoir offert à boire et à entendre ses faits d’armes et ses innombrables rêves, Jean accepte un ultime élixir proposé par un habitué. Nul ne reste indifférent aux attentions d’un homme qui, du sommet de son expérience, porte pour chacun autant d’intérêt que de tendresse. Ce soir Jean Lassalle nous a émus. Il insiste pour repartir à pieds, seul, et disparaît dans les artères de cette ville qui nous paraît alors minuscule sous ses pas.
« La vie est courte et si longue à la fois. Elle est aussi dérisoire que volcanique. Il faut cueillir tous les instants de légèreté et vivre comme si rien n’était impossible. Savoir dire oui. » Jean Lassalle
-
Messager de France

Un homme me regarde, depuis le bar. « Vous avez terminé ? » Je lui réponds que non, que les mots viennent lentement. « C’est une lettre », lui dis-je. Il m’interroge, surpris : « Pas une lettre d’amour, au moins ? » Comme s’il fallait en avoir honte. Mais non, celle-ci n’est qu’une lettre de consolation. « C’est très beau », me répond-il. Le monsieur assis à la table voisine lève les yeux : « Vous avez raison de cultiver votre écriture. » Il tourne fébrilement les pages de son petit livre, Voyage voyage, après s’être assis en s’assurant élégamment qu’il ne me dérangeait pas. « Avant, j’écrivais beaucoup, notamment à un amour impossible, une hôtesse de l’air qui recevait mes lettres aux quatre coins du monde », me raconte-t-il. « Et dans mon journal, j’écrivais les mots que je n’avais pas eu l’audace de lui adresser. C’est triste, hein ? » C’est même insupportable. S’il savait… Il aperçoit alors mon écriture : « Vous écrivez vite, c’est lisible ? » Je lui propose de lire la dernière phrase pour s’en assurer. Il n’ose pas, d’abord. Puis s’empare du carnet : « Parler, c’est souvent faire du bruit pour rien. C’est lisible, vous pouvez continuer. » Le souvenir d’un sketch de Raymond Devos lui vient alors : « Je vais parler pour ne rien dire, mais j’aimerais quand même que ça se sache ! » Nous rions. Puis il retourne à son ouvrage. Moi, au mien. Le verre est à moitié plein.
Nous sommes le 16 avril 2023. Hier soir, un déferlement de haine et de bêtises s’est abattu sur Twitter à l’annonce de l’hospitalisation de Jean-Marie Le Pen. La commémoration de l’incendie de Notre-Dame, il y a quatre ans, retombait aussitôt dans l’oubli, jusqu’à l’an prochain. Un autre monument brûlait. On ne peut pas pleurer deux morts à la fois. Le Parisien révélait toutefois que Jean-Marie Le Pen s’était mis à chanter dans l’ambulance tandis qu’elle le transportait aux urgences. Eux aboyaient en meute. Lui chantait à plein coeur. Quelle plus belle assurance de la pureté d’un homme face à l’inhumanité hurlante de ses adversaires ? En traversant la banlieue parisienne en taxi, je repensais aux mots de François Mitterrand – le comble – adressés à Anne Pingeot dans l’une de ses innombrables et merveilleuses lettres : « Ce n’est pas la mort qui m’étonne, qui m’enrage : on la rencontre à tous les carrefours ; mais la haine. Et la sottise. Et j’éprouve une sorte d’angoisse à les voir triompher, une fois de plus. »
Je refusais alors d’entrer dans cette nuit, de peur de ne jamais en sortir. Je relisais les lignes du premier entretien qu’il m’avait accordé chez lui, à Rueil-Malmaison. C’était le 21 janvier 2019. Ce récit m’avait valu de vives critiques de la part de mes responsables de formation, au CFPJ. Des retombées telles que je fus obligée d’avorter mon année, là où la déontologie journalistique appelait à la censure des idées au profit d’une pensée commune. Tyrannique.
Nous sommes donc le 21 janvier 2019.
« Si j’avais enfilé une paire de chaussons à 60 ans, je serais déjà mort. Moi, je mets plutôt mes bottes », dit-il en s’inclinant pour regagne son fauteuil. Lundi prochain, Jean-Marie Le Pen est invité à débattre sur Radio Courtoisie. Il évoquera sans doute le deuxième tome de ses mémoires dont il referme à l’instant l’ouvrage après s’être entretenu avec l’écrivain M.P. 600 pages, de 1972 à nos jours. « Il s’en est passé des choses, je suis submergé », s’inquiète-t-il. Il s’en remet donc à cette seconde mémoire qui lui dépose avant de partir une pile de documents rigoureusement étudiés qui ne formeront bientôt plus qu’un recueil d’Histoire.
Il feuillette avec hésitation son agenda repu d’entretiens, de devoirs et de noms divers. C’est ce qui lui permet de rester jeune, pense-t-il. Il ouvre ensuite le paquet que je lui ai remis : « Ce sont des chocolats ? Merci ! Mais je vais devoir les remettre à une date ultérieure parce que je suis actuellement dans une phase de volontariat d’amaigrissement. » Sa récente escapade alsacienne à Thierenbach a pourtant trahi sa résolution. Il repose la barquette de Florentins dans le sac, éteint du pied la lampe de son bureau et s’affaire à de premières excuses, après s’être perdu dans l’ordre de ses rendez-vous : « Pardonnez-moi de vous avoir accueillie comme ça, comme la surprise du chef, alors que vous étiez en effet dûment inscrite. » D’habitude, Jean-Marie Le Pen se déplace chaque après-midi à Montretout pour y rencontrer ses interlocuteurs. Nous ne sommes qu’à vingt minutes de son fief. Mais ce jour-là, c’est en la chaleureuse demeure de son épouse Jany que le patriarche me reçoit en col roulé et pantalon de velours marron, mocassins et lunettes assortis. Le bureau est installé au premier étage. L’escalier en marbre contourne une rampe d’ascenseur réédifiée après l’incendie accidentel qui avait entièrement ravagé la résidence, il y a trois ans. Jean-Marie Le Pen confit y avoir perdu de nombreux biens dont sa bibliothèque, réalimentée depuis par de nombreux ouvrages dédicacés qu’il reçoit chaque mois par dizaines : « Maintenant, je fais comme mon ami Bourdier quand il était critique littéraire de Minute, je lis la première page, je lis la dernière et à un moment donné, j’ouvre le bouquin n’importe où, j’en lis deux autres et selon mon sentiment, je le jette ou je le mets de côté. »
Trois fauteuils, une cheminée éteinte, un bureau couvert de livres, certains empilés sur la moquette, quelques grandes étagères d’un côté, de la paperasse désordonnée de l’autre, une pendule à l’effigie du Front National et quelques objets importés de Saint-Cloud de-ci, de-là… Derrière lui, un drapeau breton est suspendu à la poignée de sa fenêtre qui donne sur le jardin. Rien à voir avec le décor démonstratif de Montre-tout. Ici, tout a l’air plus simple. « Quel âge avez-vous ? » 22 ans, l’âge auquel Marion est entrée à l’Assemblée Nationale, se souvient-il. Jean-Marie n’est pas beaucoup plus âgé lorsqu’à 27 ans, en 1956, il devient lui aussi le plus jeune député. Selon lui, le jeunisme déterminera bientôt la majorité politique à 16 ans. Mais il constate en même temps que la jeunesse ne s’engage pas davantage et que le Grand Débat initié par Emmanuel Macron en devient l’effigie : « N’y viennent que des retraités ! » Ça le fait rire. « Je pense que c’est de la poudre aux yeux, c’est fait pour faire quelque chose… qu’il y ait un contact entre le peuple et la tête politique, le Président de la République que moi je trouve inodore, insipide, incolore. » Le fondateur du Front National ne parvient pas à le mettre dans une situation présidentielle, le voyant plutôt « comme ce qu’il est, un haut fonctionnaire », pourtant « compétant » et « sachant admirablement parler ! »
Il reprend tranquillement : « C’est un garçon brillant, mais je dois dire que je piaffais dans le débat avec Marine Le Pen parce qu’elle aurait dû le défoncer vivant. Elle n’avait qu’à lui parler de la captation d’Alstom par General Electric où il avait joué un rôle comme ministre des finances ; demander à Monsieur le ministre : comment avez-vous gagné 3 millions d’euros en quelques années ? Dans quelle activité ? » Mais le scénario fut autre. Il revoit Marine épuisée après une tournée de meetings « parfaitement inutiles », probablement surprise d’arriver au second tour. Il aurait même trouvé plus logique que Fillon y soit à sa place ! Elle ne s’y attendait donc pas et aurait en plus, selon son père, consommé « un dopant quelconque », lui donnant cette espèce d’euphorie « anormale » dont elle fait preuve devant Emmanuel Macron. Mais Jean-Marie Le Pen voit une seconde raison à cet échec : « Nous sommes dans un pays machiste. Les femmes ne gouvernent pas en France. Elles ont joué souvent un très grand rôle, y compris dans la monarchie, mais elles n’ont jamais atteint le sommet. L’une des plus élevées, c’est Simone Veil. Elle avait bien des atouts que d’autres n’ont pas. » Pas assez distante, pas assez royale, Marine serait donc condamnée à ne jamais accéder au pouvoir suprême : « Mais le drame eût été qu’elle gagne ! » Comme en 2002, reconnaît-il, rien n’était prêt : « Quand j’arrive au deuxième tour, j’affiche un visage plutôt grave et sérieux. Les journalistes s’étonnent que je ne sois pas joyeux, je leurs réponds que je suis inquiet parce que dans 15 jours, si je gagne – on ne peut pas l’exclure parce que Monsieur Chirac, président sortant, a fait moins de 20% des voix, donc je suis très prêt de lui, il peut y avoir une déferlante – je nomme un Premier ministre, je dissous l’Assemblée, je trouve des conseillers… évidemment, rien de tout ça n’était prêt. » Là encore, il perçoit que la victoire n’était pas prévisible et que sa présence au second tour avait été provoquée par une erreur de la gauche, celle d’avoir présenté plusieurs candidats. Mais il regrette que le débat raté de sa fille lui ait porté autant préjudice : « Le champion du monde de ski peut très bien se tordre la cheville dans l’escalier, ça ne l’empêche pas d’être champion du monde de ski et de pouvoir le redevenir quand son entorse sera terminée ! » Donc, rien n’est perdu.
Finalement, il s’assied à côté de moi. « Parmi mes nombreuses calomnies, je suis borgne, j’ai des hanches artificielles et je suis sourdingue ! »
Après s’être réinstallé, Jean-Marie Le Pen reprend sur un ton morne : « Nous allons être la proie d’un déferlement démographique étranger, dynamisé par une religion conquérante qui est l’Islam. Les chiffres sont terrifiants. La population mondiale est passée en 50 ans de 3 à 8 milliards en expansion continue. » En Algérie, le nombre d’habitants est aujourd’hui de 46 millions, contre 8 millions à l’époque. Cette explosion démographique se situe essentiellement en Afrique et en Asie et pourrait selon lui être à l’origine d’une « misère épouvantable, source de conflits intérieurs violents, de guerres civiles qui les feront déferler chez nous. » Confus de me dévoiler un tel scénario catastrophe, Jean-Marie Le Pen me prend par la main en souriant et poursuit en missionnaire repu : « Je vous dois la vérité… ma vérité. » Il n’émet pas l’ombre d’un sentiment fantasmatique dans l’esprit d’une conquête électorale ou de n’importe quelle autre séduction politique. Sur le ring médiatique, Jean-Marie Le Pen a raccroché les gants. Il castagne à la Dettinger, clandestinement, en ne s’attribuant aucune faveur. A quoi pense-t-il ? A l’heure des mémoires, le monstre arguant le déclin national ne dégage pas plus de fougue que de regret. Ni hargne, ni grandiloquence, ni scepticisme. Pour conclure avec le sujet démographique, il émet enfin l’hypothèse d’une issue fatale : une épidémie qui emporterait 5 milliards d’humains ou, plus probablement, un conflit nucléaire. « Mais dans ce cas, il est possible que ce soit la fin du monde. » Fin du court-métrage, Jany entre dans le bureau. Le tragédien l’annonce solennellement : « Madame Le Pen. »
« Vous avez eu quelque chose à boire ? Un verre d’eau, une limonade ? », introduit-elle avant de se tourner vers son époux. Elle vient de s’entretenir par téléphone avec Elisabeth de l’Escale, une généalogiste, laquelle lui aurait appris que l’un de ses ancêtres ayant été magistrat au 18ème siècle fut guillotiné à la Révolution… « Le pauvre ! », plaisante-t-elle. « Apparemment, il est né à Lorient lui aussi, donc je suis vraiment bretonne ! » C’est un bon point. Elle s’éloigne, toujours amusée, et referme la porte.
En 1963, Jean-Marie Le Pen fonde une maison d’édition, la Société d’études et de relations publiques (Serp). « On avait diffusé une centaine de disques dans un domaine plutôt étroit qu’était le document sonore. Et le premier disque a été le procès Bastien-Thiry. » Enregistré secrètement par l’un des avocats, le procès était suivi de l’exécution, « le coup de grâce. » Il publie ensuite l’histoire de la Seconde guerre mondiale en 12 disques, l’histoire de la guerre d’Algérie en 4 disques, l’histoire de la guerre d’Indochine en 2 disques, un sur le Maréchal Pétain, 12 comprenant les discours du général de Gaulle, les choeurs de l’Armée rouge, quelques chants israéliens… « Eclectique, très ouvert, 3 ou 4 disques sur le IIIe Reich avec les chants de la Wehrmacht. » Les détails de l’histoire nous apprennent que la chorale de la CGT s’y est aussi prêtée.
La société est évidemment condamnée en 1968 pour « apologie de crime de guerre ». Le patriarche transmet ensuite 40% des parts à sa fille, Marie-Caroline, laquelle « n’a rien trouvé de plus pressé que d’en obtenir 15 de plus pour me foutre à la porte. » Décidément. Jean-Marie Le Pen retire donc les 50 millions de centimes du compte courant, provoquant la faillite du label et la liquidation judiciaire, le 30 mars 2000. La maison est finalement rachetée par des amis. A ce jour, quelques 30 000 disques s’empileraient encore dans les archives de Montretout. « Le disque vinyle reste le vecteur le plus sûr, reconnaît-il. Même si dans le cas d’une gigantesque panne d’électricité, tout s’arrête. Les trains s’arrêtent, les avions tombent… C’est l’hypothèse d’une bombe. » Visiblement obnubilé par ce scénario, Jean-Marie Le Pen introduit à nouveau les effets catastrophiques d’une tête nucléaire qui exploserait à 300km au-dessus du pays : « On se retrouve comme l’homme de Cro-Magnon, les systèmes d’alimentation d’eau s’arrêtent… Au bout d’une demi-journée, il faut bien en trouver ! Ou du vin quand on a une cave… »
Connu et déprécié pour ses envolées colériques, ses déclarations incontrôlées et ses clameurs fiévreuses, Jean-Marie Le Pen s’illustre surtout par sa faculté d’improvisation. Pour parler sans papier, il faut selon lui avoir acquis une connaissance assez vaste. Ses années d’études au collège Jésuite ont amplement contribué à lui faire assimiler la nécessité de se cultiver et l’appréhension du monde qu’il percevait avec dureté : « On se levait à 5h30 l’été, 6h30 l’hiver. 4h de cours le matin, 3h l’après-midi, 2h d’étude le soir. Il y avait un sentiment d’émulation, de rivalité. Par trimestre, on apprenait 400 verbes français, 200 verbes latins, 100 verbes grecs. Edouard Herriot disait : la culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié. Oui, mais à condition d’avoir beaucoup appris ! Sinon, on est un esclave intellectuel. » Ni son père, ni son grand-père n’avaient été scolarisés. Ils étaient nés marins pêcheurs, comme lui. Son père s’est engagé à l’âge de 13 ans à bord d’un trois-mâts cap-hornier, en 1914. Il naviguait jusqu’au Chili, le bateau rempli de nitrate. Mainte fois torpillé, jamais coulé ; il est mort à la mer en percutant une mine.
Son grand-père avait 13 frères et sœurs. Tous travaillaient pour faire vivre le foyer, certains marins, d’autres bergers. Jean-Marie est quant à lui fils unique. « Je fais partie de cette génération d’entre les deux guerres où la France est morte. Elle ne le sait pas encore mais elle est morte. Il y a 50 ans, les populations exotiques avaient 20 enfants. 2 survivaient, 18 mourraient. Maintenant, il y en a 18 qui survivent et 2 qui meurent. » Il appelle ça « le pullulement mondial. » Un seul continent aux accents « boréals », de Vladivostok à Gibraltar, a toutefois une démographie négative où naissent moins de gens qu’il n’en meurt. En France, Jean-Marie Le Pen relève une infériorité des naissances pour la 4ème année consécutive, malgré la présence d’immigrés. « La femme française s’étant dotée d’une profession va d’abord se consacrer à celle-ci. Si elle a un coup de foudre pour Jules, elle va faire son premier enfant à 30 ans, le deuxième à 36 et après on arrête… Et ça, ce sont des gens qui ont des principes, sinon on n’en fait aucun », conclut-il.
« Alors, comme disait Lénine, que faire ? Qu’espérer… La vie commence toujours demain, après tout. »
Gérald Gérin, son assistant parlementaire, entre dans la pièce. Il vient de recevoir un faire-part pour les obsèques d’André Pertuzio qui auront lieu demain, mardi 22 janvier, en l’église Saint Sulpice. Jean-Marie Le Pen ne peut évidemment pas s’y dérober, ce fut l’un de ses compagnons de route. L’un des derniers. « Il avait 97 ans. Nous faisions partie d’une association des anciens présidents de la corpo de droit et son décès fait de moi le doyen. » Son école politique. Il y a connu sa première élection comme cadre de l’UNEF qui était en ce temps-là unitaire : « Il y avait tout le monde, l’extrême gauche comme l’extrême droite. »
Au cours de son doctorat, Jean-Marie Le Pen rejoint le premier bataillon de chasseurs parachutistes de la Légion Etrangère en Indochine, persuadé que tout se passe là-bas. Mais en 1955, il revient en France et décide avec deux autres camarades de se présenter aux élections, « pour leur cracher à la gueule. » Quand Edgar Faure dissout l’Assemblée, on lui conseille de prendre contact avec Pierre Poujade. Désireux d’en apprendre davantage sur son discours, ses auditeurs et sa réputation, il assiste à l’une de ses réunions dans une ancienne église de Blois. « Un orateur inspiré, très midi moins le quart, mais bon. Il y avait environ 2000 personnes. Au premier rang, des cadres. Derrière, les commerçants qui avaient mis leurs costumes du dimanche. Et derrière encore, les paysans avec leurs bottes, casquettes et canadiennes. C’était l’hiver. » Convaincu, Jean-Marie se présente à ses côtés. Il est élu au premier tir et devient l’orateur du groupe. Quelques mois plus tard, Pierre Poujade est temporairement écarté, soupçonné de vouloir échapper au pouvoir auquel Jean-Marie et ses camaradent prétendent. Ils repartent alors pour l’Algérie avec le 1REP. « J’ai participé au débarquement de Suez et à la bataille d’Alger contre le terrorisme. Je suis revenu au parlement et j’ai été réélu en 1958, député du quartier Latin et du 5ème arrondissement de Paris. En 1962, j’ai été battu et j’ai fait une traversée du désert jusqu’à 84 pratiquement où j’aurai 10 députés européens. Puis 35 députés nationaux en 1986. Et ainsi de suite… L’histoire de ma vie. »
Sur un air d’Alain Barrière, compatriote de la Trinité-sur-mer, Jean-Marie réalise justement qu’il doit y retourner au printemps fleurir la tombe de sa famille… et préparer la sienne. « Nunc dimittis ! Je n’y ai jamais pensé avant 90 ans. Je me suis dit : là, tu entames la dernière ligne droite. Combien de temps va-t-elle durer ? 1 an, 2 ans, 5 ans, 15 jours ? » In saecula saeculorum. Il n’est pas pressé. Madame Calmant est morte à 122 ans, elle disait : « Je n’ai qu’une seule ride, je suis assise dessus. »
« Un jour, je reçois une invitation absolument étonnante venant de Krim Belkacem. J’hésite quand même parce que je ne suis pas en odeur de sainteté dans ces milieux-là. Puis j’accepte« , me raconte-t-il. Il embarque alors dans une voiture où l’attend l’ancien représentant du FLN. Ils discutent un certain temps puis Jean-Marie Le Pen finit par lui demander pourquoi il a souhaité le rencontrer. Krim Belkacem lui répond simplement avec un sourire : « Je voulais te connaître. » En remontant dans ses souvenirs, Jean-Marie Le Pen cherche toutefois une raison qui aurait joué en sa faveur. La guerre d’Algérie. Lors de l’expédition de Suez, il se trouve chargé d’enterrer de nombreux morts du camp adverse. Il fait donc creuser des fosses communes et, respectant le dogme musulman, oriente les cadavres vers la Mecque en n’omettant pas de retirer leurs chaussures. « Je ne suis pas du tout coraniste, je n’ai ni tendresse ni bienveillance pour l’Islam mais les morts, c’est les morts. » Paradoxalement, sur la rive adverse, une unité de parachutistes français balance les corps à la mer. Le FLN n’aurait donc jamais attenté à ses jours en raison de cette considération accordée aux musulmans : « J’avais aussi été le premier à présenter la candidature d’un arabe à la députation à Paris, en 1957. La réputation de Le Pen raciste m’a fait rigoler. La première fois que j’ai été député, mon deuxième de liste était noir ! Roger Sauvage, un pilote de Normandie-Niemen, martiniquais. »
Fasciste, raciste, homophobe, antisémite, nazi… Jean-Marie Le Pen cumule les étiquettes mais n’y accorde pas grand intérêt. Placé très tôt au banc de la société, il se définit sans complexe et en rajoute : « Je suis l’un des rare qui suis fier de la colonisation française. J’ai traîné mes bottes dans le monde, quand même. J’ai vu le vaste monde et je trouve que ce que nous avions fait, c’était plutôt sympa. Bon, ce n’était pas parfait, sans doute… Je n’ai aucun lien particulier avec les colons, je n’ai pas non plus d’hostilité systématique. »
Roland Dumas m’avait affirmé être resté en sympathie avec Jean-Marie Le Pen. C’est confirmé : « Nous faisions partie du bureau d’âge de l’assemblée de 1956. Roland était le plus âgé et moi j’étais le plus jeune. Son père a été fusillé pendant la guerre. » Jean-Marie Le Pen redit avoir toujours été dans l’opposition, jamais ministre, et de s’en être bien passé. Ça n’était pas son ambition, affirme-t-il : « J’ai vu tant de médiocres le devenir… Je n’aurais pas considéré comme déshonorant de l’être si ça correspondait à une politique que je soutenais. Mais comme en général, j’étais toujours très réservé à l’égard des initiatives du pouvoir et que la France n’a cessé de décliner durant toutes ces années… » Combattant de l’arrière-garde, le menhir reconnaît avoir reculé toute sa vie, mais en tirant : « J’ai reculé à reculons ! »
Il reprend : « Un taux excessif d’étrangers rend la société déstabilisée et la met en danger. Parce que les peuples envahissants ne sont pas forcément bienveillants et tendres. » Nous confronterons-nous au dilemme du plus grand nombre ? Jean-Marie Le Pen dit avertir depuis des années les gens du monde, compatissant d’une misère profonde, qu’il ne fait pourtant pas sienne : « Mon problème à moi, c’est de défendre les Français », martèle-t-il. Quand un étranger entre sur le territoire sans y être invité, il n’a, selon lui, droit à rien : ni logement, ni travail, ni école, ni hôpital, ni aide sociale. « Nos lois sociales sont déjà en elles-mêmes ruineuses. »
De temps en temps, le patriarche imagine un film catastrophe. Le dernier commence à Mantes-la-jolie. « Un accrochage entre la police et les arabes, 3 policiers tués, 10 arabes tués. Trois jours après, 200 000 personnes sur les Champs-Elysées qui descendent des banlieues. Barrages de CRS, de gendarmes… Ils prennent l’Elysée. Le Président ne mourra qu’au trentième amant (rires). Ils continuent à avancer vers la Concorde, mais on a réussi à attraper de justesse une compagnie du 2REP qui est sur cette place et à qui on a demandé de ne laisser passer personne. Ils mettent les mitrailleuses en batterie et quand la foule arrive, ils tirent. Les gens continuent d’avancer, c’est pas qu’ils le veulent, mais c’est que les 100 rangées poussent derrière. 1200 morts. Interpellation à l’ONU. La France est condamnée par 85% des voix et l’ONU décide d’envoyer 5 régiments de parachutistes musulmans égyptiens, marocains, tunisiens, algériens en France pour rétablir l’ordre. Voilà. C’est mon film catastrophe. Est-ce qu’il est invraisemblable ? »
Vient alors le sujet de la religion. A 16 ans, Jean-Marie Le Pen est dégoûté par l’Eglise à cause d’une mauvaise blague. Un curé lui fait croire que sa mère est morte pour le pousser à quitter l’école en raison de son mauvais comportement. Depuis, il se considère comme « ami de la religion catholique » en assistant à certains offices, en entretenant des relations cordiales avec certains membres du clergé. Lorsqu’il rencontre Jean-Paul II, ce dernier lui prend la main et lui adresse un regard muet aux airs compatissants. « Ça voulait dire : continue vieux frère », se console-t-il. « Mais je ne suis pas un bon chrétien. Il y en a de moins en moins d’ailleurs. Quand elles ne sont pas remplacées par des mosquées, les églises sont détruites… C’est la fin du monde. Il y aura peut-être une renaissance, après tout ! Rien n’est perdu. Ou plutôt si, comme disait François Ier : tout est perdu, fors l’honneur ! »
Nous sommes toujours le 21 janvier 2019 et Jean-Marie Le Pen se dit aujourd’hui en convalescence. Il vit au milieu de nombreux livres, la conscience tranquille, l’esprit vif et la mémoire infrangible. Il ne regrette rien, ou peut-être de ne pas avoir toujours été compris. Il se souvient de tout, y compris de Fanchon dont il me sert le premier couplet suivi de son refrain à boire. On ne pouvait pas se quitter sans chanson : « Voilà, vous avez vu le monstre. On vous demandera : tu es venu chez lui ? il t’a reçu ? tu n’avais pas peur ? C’est un monstre gentil ! » Il rit encore. Marin pêcheur de chalutier, mineur de fond, légionnaire parachutiste… « Je n’ai pas fait carrière, j’ai avancé en marchant. Ce sont les événements qui font beaucoup plus que les destins, que les projets eux-mêmes. Je pense que j’aurais pu être un grand avocat, encore qu’il y a des servitudes que je ne supporte pas : se présenter à 13h pour passer à 18h ou 19h, c’est insupportable ! » Si tout était à refaire ? La question ne se pose pas. Jean-Marie Le Pen a marqué l’histoire de notre pays. Ceux qui l’écrivent en feront ce qu’ils veulent, pourvu qu’ils ne cèdent pas la plume aux caricaturistes : « Au regard des galaxies, qu’est-ce que nous sommes ? Vous avez vu notre galaxie ? C’est une parmi des milliards. C’est passionnant, ça… Mais l’homme né de la femme a une vie brève. » Job 14…
« Profitez de vos 20 ans. Vivez la vie. Vous allez peut-être voir des choses difficiles. L’essentiel est d’être en bonne relation avec sa conscience, avec son cœur. » En ce qui le concerne, c’est acquis.
16 avril 2023. Aujourd’hui, Jean-Marie Le Pen est entouré des siens dans un hôpital de la région parisienne. J’avais écrit ces vers pour combattre l’ennui. Les événements leur donnent un sens :
Aimer, se battre, brûler, s’enivrer sans cesse,
S’abandonner aux songes pour mieux les servir,
S’émerveiller de tout, de ses propres faiblesses,
Naître, vaincre, mourir ; par devoir, par désir.Confier aux cieux l’espérance d’un soir :
Ne tomber à genoux qu’en portant cette croix,
Pour l’honneur et pour Dieu, pour la France, la gloire,
L’élever en criant : vous ne passerez pas !Se dérober aux hymnes. On ne meurt pas pour soi.
On s’effondre d’amour, on s’abaisse, on s’exile.
Le combat nous allie et la mort nous envoie
Vers les plus nobles plis, pauvres fous, indociles.
-
S'abonner
Abonné
Vous disposez déjà dʼun compte WordPress ? Connectez-vous maintenant.